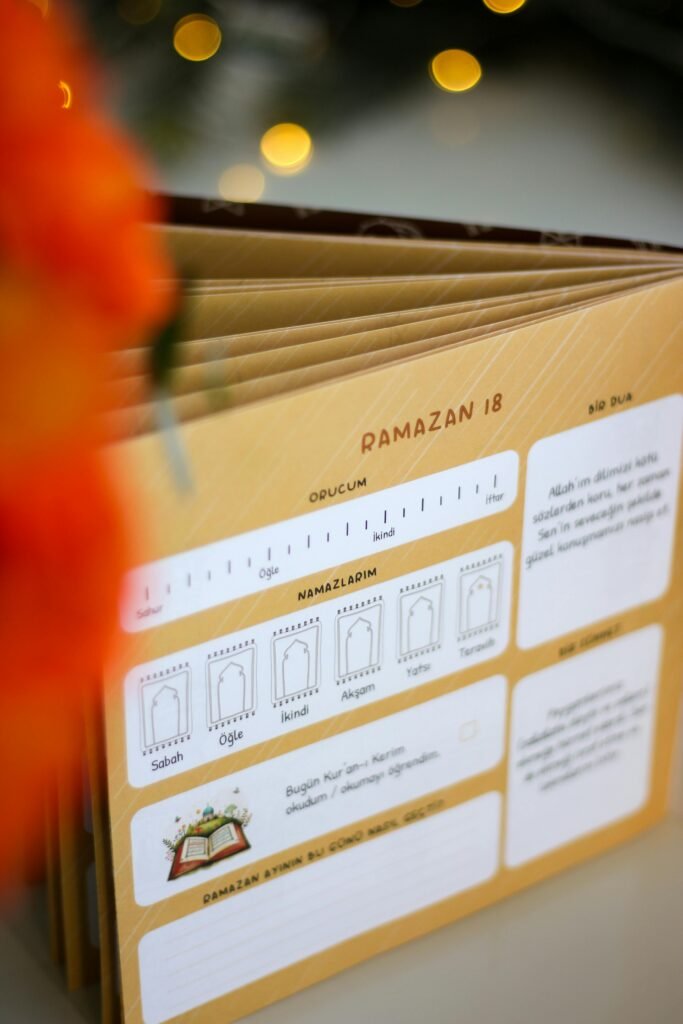Vous vous êtes déjà demandé comment fonctionne le calendrier musulman ? Pourquoi le Ramadan tombe à des dates différentes chaque année ? Découvrez l’univers fascinant du calendrier hégirien, cette mesure du temps qui rythme la vie de plus de 1,8 milliard de musulmans à travers le monde.
Aux origines du calendrier musulman
C’est dans le contexte historique de l’an 622 que prend racine ce calendrier unique. Cette année marque en effet l’Hégire, ce voyage déterminant du prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, qui quitta La Mecque pour s’établir à Médine. Cet événement fondateur, qui, d’apparence, correspond à un simple déplacement, marquera par la suite l’histoire islamique en devenant le point de départ du calendrier musulman.
Le calife Omar ibn al-Khattab officialisa plus tard ce système de datation, choisissant l’Hégire comme point de départ du calendrier musulman. Un choix qui témoigne de l’importance spirituelle, mais aussi historique de cette migration. Aujourd’hui encore, des musulmans font le choix de perpétuer cette Sounnah en quittant des pays non-musulmans pour s’établir dans des pays musulmans. Il s’agit de la hijra, considérée comme obligatoire selon les avis émis par les gens de science.
Le rythme du calendrier musulman dicté par la lune
Contrairement au calendrier grégorien basé sur le cycle solaire, le calendrier hégirien suit exclusivement les phases lunaires. Cette particularité lui confère un caractère dynamique et une connexion étroite avec la nature.
Chaque mois débute avec l’apparition du premier croissant de lune, qu’on appelle notamment hilal en arabe, après la nouvelle lune. Cette observation directe du ciel, pratiquée depuis des siècles, crée un lien entre les fidèles et la création d’Allah. Aujourd’hui encore, dans de nombreux pays musulmans, des comités d’observation se réunissent pour guetter l’apparition de la nouvelle lune.
Cette dépendance aux cycles lunaires explique d’ailleurs pourquoi l’année hégirienne compte environ 11 jours de moins que l’année grégorienne (354 ou 355 jours contre 365 ou 366). C’est aussi la raison pour laquelle les fêtes islamiques « se déplacent » à travers les saisons au fil des années. On ne peut donc pas prédire avec précision les évènements importants liés à la tradition islamique. Certains calendriers font des prédictions. Mais on ne peut s’y fier totalement.
Les douze mois du calendrier islamique
Le calendrier musulman se compose de douze mois :
- Muharram (المحرّم)
- Safar (صفر)
- Rabi’ al-Awwal (ربيع الأول)
- Rabi’ al-Thani (رَبِيعُ ٱلثَّانِي)
- Jumada al-Awwal (جمادى الأول)
- Jumada al-Thani (جُمَادَى ٱلثَّانِيَة)
- Rajab (رجب)
- Sha’ban (شعبان)
- Ramadan (رمضان)
- Shawwal (شوّال)
- Dhul-Qi’dah (ذو القعدة)
- Dhul-Hijjah (ذو الحجة)
Les mois sacrés
Parmi ces douze mois, quatre possèdent un statut particulier en islam. Mentionnés explicitement dans le Coran comme étant sacrés (hurum), ces mois étaient déjà respectés dans l’Arabie préislamique :
- Muharram
- Rajab
- Dhul-Qi’dah
- Dhul-Hijjah
Durant ces périodes sacrées, les musulmans sont encouragés à intensifier leurs bonnes actions et à s’abstenir particulièrement de tout péché.
Au-delà d’un simple système de datation, le calendrier musulman structure la vie spirituelle et sociale des musulmans. Il détermine les moments de jeûne, les grandes célébrations comme l’Aïd et même des aspects pratiques comme le calcul de la zakat (aumône obligatoire). Cette dimension temporelle rappelle constamment au croyant l’importance de vivre en harmonie avec les cycles naturels et d’accorder son cœur au rythme de sa spiritualité.